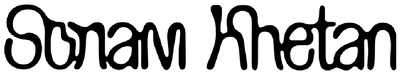To enter the book of Yves Marchand and Romain Meffre is to step into a parallel universe, as if one could suddenly step into a video game or in a Piranesi etching, or like the heroine in Woody Allen’s film The Purple Rose of Cairo, if we were able to go through the silver screen. The duo of photographers who have been photographing the decaying remnants of Western civilization (they have published a book on Detroit, and another one on old theaters) have just published a beautiful and troubling book Les Ruines de Paris - Paris’ruins.
To enter the book of Yves Marchand and Romain Meffre is to step into a parallel universe, as if one could suddenly step into a video game or in a Piranesi etching, or like the heroine in Woody Allen’s film The Purple Rose of Cairo, if we were able to go through the silver screen. The duo of photographers who have been photographing the decaying remnants of Western civilization (they have published a book on Detroit, and another one on old theaters) have just published a beautiful and troubling book Les Ruines de Paris - Paris’ruins.![]()
With this large size book, we enter a Paris both mysterious, unsettling and fascinating. The city is eerily silent. Not a living soul, not even a rate rummaging for food. Instead, the empty city has become a city of ruins overrun by nature. Trees sprout from the roof of buildings, the river has set itself free from its banks, streets and highways are slowly returning to their original state. The Eiffel tower is just a heap of metal. The Museum of natural history’s dinosaurs are in a terrible shape. It’s a truly apocalyptic scene.
Where are the residents ? What has happened ? Was it a sudden catastrophe which wiped out any form of human life from the capital ? In Pompeii we know there was a volcanic explosion in 79 B.C., but here, in Paris, what catastrophe has produced this desolation ? In the past, ruins were a way to connect people with what came before them, like in the paintings of 18th Century artists. Ruins were also a metaphor for the brevity of our lives on Earth. Not here. These images are a metaphor for our anxiety in the face of the destruction of our planet. The fact that there is no explanation we can find to the desolation adds to the power of the images. Marchand & Meffre’s work is a total break from the past. Instead of looking at the past - Pompeii, Roman ruins, etc. - they seem to be photographing the future, our future.
![]()
The photographers have used AI to invent a Paris in ruins. It’s been a monumental task. To generate one image, the photographers had on average to create 650 iterations. 52.000 images had to be created to come up with the 80 images in the book. “Sometimes it was difficult for AI to generate some images. For example, it was very hard for AI to imagine an empty swimming pool. It was probably not trained enough to understand this paradox,” explain Marchand & Meffre. For humans, no need to train them to understand the catastrophe awaiting if we continue on this path. This book is a warning.
~Jean-Sébastien Stehli
Ruines de Paris (Albin Michel publishers). Yves Marchand & Romain Meffre.
![]()
Just before they were signing their book, Les Ruines de Paris, we spoke with Yves Marchand and Romain Meffre. Here’s an excerpt from our interview.

Q. Comment avez-vous commencé à vous intéresser aux ruines ? Quel a été le déclic ? Avez-vous tout de suite pensé que c'était votre voie ?
Yves Marchand & Romain Meffre Cela tient au départ à une curiosité assez candide que beaucoup de gens éprouvent face aux ruines, entre la répulsion et la fascination. Nous avions dès l’enfance un goût pour les paysages escarpés, les phénomènes naturels extrêmes, les châteaux forts à l’abandon... etc., une recherche du sentiment du sublime qui est d’autant plus prégnant lorsque nous sommes à un âge où tout nous dépasse en tout point. Cependant, nous n’étions pas forcément les plus transgressifs et nous avons finalement attendu l’adolescence et le début de l’âge adulte pour franchir le pas, en 2002, et oser s’aventurer dans ces lieux souvent interdits avec la photo pour prétexte. C’est d’abord une expérience extrêmement ludique puisqu’elle permet d'explorer et de découvrir une histoire et une géographie alternatives par soi-même, en toute liberté de déplacement et de temps dans des lieux donnés, ce qui est rare. Ensuite, il y a assez rapidement un sentiment de sidération face à la qualité des édifices qu’on peut trouver à l’abandon, donc proches de disparaître, et on ressent vite une certaine “responsabilité” et une certaine légitimité dans cette démarche de documentation visuelle. Enfin, la pratique de la photo en ces lieux requiert un certain calme et est remarquablement en adéquation avec l’idée d’observation et de contemplation que l’on éprouve. Ce sont d’ailleurs ces divers aspects qui ont fait de l’exploration des ruines une culture désormais populaire. Pour nous, c’est notre voyage à Detroit en 2005, puis le fait de réaliser une exposition des photos l’année suivante qui nous a fait comprendre que l’on pouvait envisager de vivre de notre passion.
Q. Comment avez-vous pensé le projet sur les ruines de Paris ? Ce n'est pas évident parce qu'il faut éviter les clichés, les images déjà vues.
Nous avons d’abord fait une première tentative de produire une rue parisienne en ruine en janvier 2024, le résultat était approximatif mais troublant. Nous nous sommes dit que si, malgré notre expérience du sujet, nous étions perturbés, cela valait la peine de creuser, et l’idée de transformer un univers, une réalité que l’on connaissait bien semblait logique.
Paris est “notre“ ville, en tout cas la grande ville que l’on connaît le mieux, et qui, de surcroît, possède une identité visuelle reconnaissable entre toutes. C’est pour ça qu’il est généralement difficile de photographier Paris : son paysage est tellement marqué par ses monuments qu’ils s’imposent dans la plupart des images. La charge symbolique qu’elle porte est sans doute trop forte pour s’extraire des représentations attendues. Mais c’est précisément cette force qui fait de la capitale un objet visuel propice au détournement et un socle solide pour l’imagination. Cela était donc l’occasion de déployer notre “ruinomanie” et nos fantasmes apocalyptiques et de transformer Paris en ruines. De fait, c’est presque un exercice de style en soi, car cette vision traverse la littérature, le cinéma, la BD et la photographie, puisque la Commune de Paris de 1871 avait été extrêmement documentée par les photographes en quête d’illustrations des combats et fascinés par cette transformation partielle de la capitale en vestiges, qui appartenait peu de temps avant à l'exotisme oriental des voyages en Grèce ou au Moyen-Orient. Pour notre part, nous avons essayé de coller de manière relativement pragmatique au sujet de la série en répondant à la question : si Paris était en ruines, où irions-nous en tant que photographes, quels seraient les sujets qui la représenteraient le mieux et qui auraient du sens dans un sujet qui parle des ruines ? Nous avons fait une liste : il fallait commencer par les espaces de circulation, rues et places, qui sont en réalité les espaces que l’on emprunte le plus, puis les ponctuer de certaines scènes d’intérieur, lieux de vie, monuments et musées. Ensuite, nous comptions sur notre habitude visuelle de l’abandon, plus la grande puissance de synthèse de l’IA, pour en livrer une version “réaliste” visuellement en se basant sur ce que l’IA était capable de faire, car tout n’était pas possible.
Q. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées pour réaliser Les Ruines de Paris ?
Les IA génératives ont été marketées comme presque “magiques”, comme s’il suffisait, en quelques prompts et indications textuelles, d’obtenir ce que l’on voulait. En réalité, se rapprocher d’une idée visuelle précise nécessite un long processus qui consistait à mélanger une suite de 5 ou 6 images : photographies personnelles, images d’archives, captures d’écran Google Street, le tout souvent remonté ensemble avant ingestion par Midjourney, et ensuite nous “promptions” pour “forcer” l’IA vers l’idée directrice. Quand certains monuments comme la Tour Eiffel ou l’Arc de triomphe pouvaient être obtenus relativement facilement, pour plein d’autres cela produisait des chimères, des édifices hybrides, fruit du corpus d’images d'entraînement de l’IA, donc de ses biais. Le Panthéon était par exemple invariablement un mélange de celui de Rome et de Paris, donc peu évocateur; pour la Tour Montparnasse, la Tour Eiffel réapparaissait régulièrement enchâssée à l’intérieur de la première, car, là encore, le mot “tour” associé à “Paris” emmenait la génération d'images vers cette probabilité-là. Ensuite, il fallait aussi emmener ces monuments vers la ruine, et cela modifiait invariablement leur architecture lors des générations d’images. Tous ces paramètres ont rendu le protocole vraiment laborieux. Il fallait aussi tempérer le côté baroque et boursouflé du résultat, et nous avons souvent fait le choix d’images qui n’étaient pas les plus esthétiques, pour aller vers des architectures et des lumières moins spectaculaires et plus troublantes. Enfin, l'infinité de résultats possibles est évidemment un danger et, si on ne choisit pas de fortes contraintes, on peut rapidement se perdre. On dit souvent qu’être photographe c’est faire des choix; en réalité, cela n’a jamais été aussi applicable que sur ce projet puisqu’on a “produit”, à l’aide de Midjourney, plus de 50 000 images pour 80 sélectionnées. Évidemment, beaucoup provenaient d’une même arborescence sur un sujet, cependant les allers-retours ont été très nombreux.
Q. Dans votre travail, vous inspirez-vous des artistes du passé - Piranesi, Hubert Robert, mais aussi Victor Hugo, Dali, etc. ?
Oui, lorsqu'on travaille sur le motif des ruines, il y a un certain nombre de références qui émergent de manière plus ou moins évidente et consciente, tant le sujet de la représentation du temps qui passe et notre vanité traversent les arts et l'architecture des villes. L’usage de la chambre 4×5 nous inscrit déjà dans une tradition picturale classique, en écho aux Vedute et aux peintres classiques des ruines. La photographie, quant à elle, s’est dès sa naissance attachée à enregistrer les monuments menacés ou disparus puisque le premier recueil photographique publié, celui de Maxime Du Camp en 1853, recensait les vestiges d’Égypte et du Moyen-Orient. L’immense engouement des photographes pour les ruines de la Commune a renforcé les liens entre image, disparition et mémoire. Ce projet nous en a fait reprendre pleinement conscience. Dans Les Ruines de Paris, la galerie du Louvre en ruine peinte par Hubert Robert était évidemment une référence incontournable qui donnait du corps à notre série, tout comme Victor Hugo et sa Notre-Dame, ou encore l’imaginaire monumental de la ville elle-même, imprégnée des réminiscences des empires passés qui apparaissent dans les motifs classiques des façades.